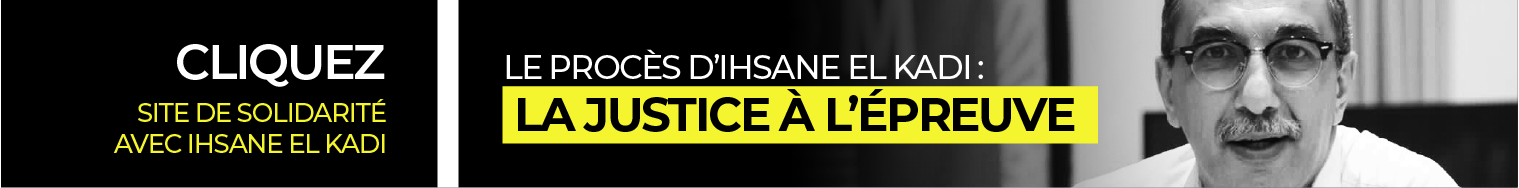Le poignant film de Bachir Derrais sur l’un des symboles les plus puissants du martyr révolutionnaire ne sera pas projeté en Algérie avant un changement démocratique. Pourquoi ? Réponse après visionnage.
Il n’y a, bien sûr, les raisons « conventionnelles » pour ne pas retenir ses larmes. Elles sont profusion durant le visionnage de Larbi Ben M’hidi. Et à sa fin. La performance éblouissante de réalisme de Khaled Benaissa dans le don de soi. Le martyr, si peu connu, du jeune frère, Tahar Ben Mhidi. L’exécution insoutenable dans une ferme de la Mitidja aux bons soins de l’officier Aussaress (Bruno Claifond). Il y’a surtout l’imprévu. Le non conventionnel. La révélation oppressante, plan-séquence après séquence, que cette œuvre artistique qui revisite le récit national avec les codes de la liberté est, en fait, un aveu déprimant. L’Algérie « officielle » n’est pas prête. Elle ne peut pas, 64 ans après sa mort, regarder un de ses héros, tel qu’il fut. Et elle empêchera les Algériens de le voir dans les salles de cinéma tant qu’elle sera là. C’est cette fulgurante évidence que dévoile, portée à l’écran, la vie à couper le souffle de Larbi Ben Mhidi. Une raison inattendue de pleurer. Sans retenue.
Et pourtant on connaissait la fin
Pour faire sens, il faut d’abord faire œuvre. Une autre révélation à la fin du visionnage. Larbi Ben Mhidi est aussi censuré pour cela. Parce que c’est une œuvre cinématographique aux standards mondialisés de cette industrie. Elle peut parler à tous. Ici et ailleurs. Laisser une empreinte. Le film échappe aux brouilleurs de perception. Fréquents en particulier dans une biographie portée au cinéma, un biopic. Un récit dont on connaît la chute, et dont les protagonistes ont déjà préempté une émotion mémorielle chez nous. Scénario, Production et réalisation ont avantageusement contourné les trappes classiques.
La direction de la photographie (Ugo Lopinto) a trouvé les plans et les couleurs qui connectent immédiatement avec l’Epoque. Le site, verdoyant, de tournage en extérieur pour l’enfance de Larbi, est grandiose. Le rendu du Biskra colonial est bluffant dans les décors des studios tunisiens, et les costumes (Jean Marc Mereite) généreusement fidèles. Les dialogues vifs et réalistes dans la langue qu’il faut, selon les situations. La tonalité vient, d’entrée, du bon coté sensoriel du cerveau : peu ou pas de chute dans les clichés ou le manichéisme, de recours aux raccourcis historiques. La réalisation est appliquée, bien servie par une adaptation brillante (Abdelkrim Bahloul), du scénario originel (Mourad Bourboune).
Le montage (Benedicte Brunet et Stratos Gabroelidis) alterne opportunément les « stop and go », combinaison d’accélérations et de pauses nécessaire à la compréhension du contexte historique tout autant qu’à l’intrigue. Le rythme ne retombe quasiment jamais, en dépit des figures imposées dans le genre : soutenir le déroulé d’une vie, – quelle vie – en moins de deux heures. Le film tutoie dans ses codes, la légende de la « Bataille d’Alger » de Gillo Pontecorvo en reconstituant la scène mythique de l’exfiltration des bombes du FLN de la Casbah. Tout pour rester ferré, sans broncher, dans le sillage de Larbi Ben M’hidi, de Biskra, à Oran, puis à Alger, puis au Caire, puis à la Soumman, et enfin à la Casbah. Reste le casting. Il dessert rarement le film.
Les arbitrages sont optimaux entre privilégier la ressemblance physionomique ou la performance d’acteur. Larbi Ben M’hidi est convaincant dans ses deux époques, la jeune et l’adulte. Ses pairs de la photo des six à Bab El Oued, sont d’inégale pertinence, mais assurent. Plus tard, les interprètes de Abane (Nadal Mellouhi), Benkhedda (Mohamed frimehdi) et Zighout (Mabrouk Fetoudji) donnent une épaisseur incarnée à l’intrigue politique autour d’un époustouflant Khaled Benaissa (Ben M’hidi adulte). Les personnages féminins, jamais trop en retrait, alimentent, la mère de Larbi notamment (Lydia Larini) avec justesse sa permanente tension dramatique. Le film de Bachir Derrais, recèle bien quelques faiblesses. Elles sont marginales et attendront, un jour, une sortie publique pour méritaient de devenir un thème.
L’essentiel aujourd’hui est ailleurs. En passant le test de la qualité cinématographique pure, le biopic réussi à faire baisser la garde aux spectateurs. Hypnose de la salle sombre. Il peut alors suggérer que l’on s’identifie aux acteurs et aux situations. Il détient bien l’arme atomique du cinéma, son code subversif. L’œuvre peut faire sens. Elle devient problématique. Pour les autocrates, gardiens du temple en fin de vie.
Qui va s’identifier à qui ?
A la fin de la projection, mon ami, Larbi Merhoum, le neveu de Larbi Ben M’hidi, a lancé, face à l’émoi général déclenché par le film, une invitation piquante à la controverse : « On voit bien que chaque hirakiste peut facilement s’identifier à Larbi Ben M’hidi. Le problème, c’est que, aujourd’hui, ceux d’en face ne sont pas des Massu et des Bigeard, mais des Algériens qui aiment aussi, à leur façon, leur pays ». Si le biopic prêt à la diffusion depuis 2017 n’a pas pu débuter sa carrière en salle, c’est justement pour la raison inverse. En effet, si le Hirakiste s’identifie à la victime héroïque, le régime de Bouteflika redoutait de se reconnaître dans le bourreau maléfique. Et de prendre le risque d’être identifié comme tel par le grand public. En surface, les « réserves » du département des Moudjahidine co-producteur du film portaient sur « quelques séquences inexactes », du point de vue historique, selon les gardiens du temple. Le visionnage de Larbi Ben M’hidi déboute très vite ce « scénario » angélique.
Le film est une rupture tonitruante avec l’hagiographie traditionnelle sur le récit national. Les révolutionnaires étaient des hommes, sublimes, avec leurs doutes et leurs contradictions. Ils étaient d’accord sur le cap. Ils pouvaient diverger, violemment, sur le rythme de la marche, les priorités de l’étape. Le montrer comme l’a fait Bachir Derrais changeait tout. Un régime de Bouteflika en bout de parcours n’allait sans doute jamais trouver en son sein la ressource éthique d’un dépassement « révolutionnaire » du narratif officiel par l’art populaire du cinéma. Le régime qui le prolonge aujourd’hui, effondré sur lui même, le peut infiniment moins. Car entre temps, il y’ a eu l’irruption du Hirak en 2019. Un nouveau récit national qui réorganise autrement le récit officiel, ancien.
Le film Larbi Ben M’hidi annonce comme un oracle le retour de la Soummam, dans la conception de l’Etat. La primauté du civil sur le militaire. Il donne une esthétique à l’engagement du commandant Bouregaa, héros de la connexion des deux combats, national puis civique, dans la continuité de la primauté de l’intérieur sur l’extérieur et donc de l’ALN des wilayas sur celle des frontières. Explosif. Prémonitoire. L’identification contemporaine des Hirakistes, c’est à dire d’un pan considérable du peuple, avec Larbi Ben M’hidi du film de Derrais porte en elle, la force potentiellement subversive semblable à des dizaines de vendredi de marches populaires. Elle a même passé les barbelés de la censure.
La marche de Bab El oued a bien lancé en décembre 2019 le slogan « Abane, Kalkoum (vous a dit)… », pour donner une filiation de la revendication démocratique de « l’Etat civil pas militaire » avec les mythes fondateurs de l’Algérie indépendante.
Ben M’hidi marqueur historique
La réalisation de Bachir Derrais a t’elle un parti pris en faveur du CEE de la Soummam contre la délégation extérieure du Caire ? Forcément, si la caméra est placée du point de vue de Larbi Ben M’hidi. Sans forcer le trait. Mohamed Boudiaf, coordinateur du déclenchement à l’intérieur, est au Caire à coté de Ben Bella lorsque Larbi Ben M’hidi vient, début février 1956, s’enquérir, auprès de la délégation extérieure du FLN, de l’approvisionnement en armes de la Révolution. Avant de revenir en Algérie via le Maroc.
Les destins peuvent se dérouter et les rôles s’inverser. Comme dans cette réunion cruciale du CEE en plein bataille d’Alger où doit être discuter « le repli de la direction » de la révolution en dehors de la capitale, en fait très vite en dehors du pays. L’intérieur va passer à l’extérieur. Mais le politique lui prétend toujours à sa primauté sur le militaire. Difficile à montrer aux Algériens en 2017 sous Bouteflika. Impensable en 2021 sous Tebboune. Le destin de Larbi Ben M’hidi est donc celui là. Celui de devenir un marqueur éternel. Hier par sa vie, par son martyr, aujourd’hui par la modernité de son combat. Un marqueur de quoi ? Le 16 janvier 2011, je marchais sur l’avenue Habib Bourguiba , cinq jours après la chute du président Benali, venu couvrir la Révolution du jasmin pour Maghreb Emergent.
Je cherchais les signes du changement, lorsque je suis tombé, débordé par l’émotion, sur le dernier livre de mon ami Toufik Ben Brik, journaliste dissident, qui a largement contribué à montrer la dictature de Benali sous son vrai jour onze ans auparavant. Il était en « vedette » à l’avant de la vitrine de la plus grande librairie de Tunis. Impensable une semaine avant. Le changement démocratique était là sous mes yeux. Le jour ou « Larbi Ben M’hidi » le film de Bachir Derrais sera projeté dans les salles de son pays tel que je l’ai visionné, ce sera pareil pour l’Algérie. A chaque Révolution son Marqueur du point de bascule. A chaque œuvre artistique son destin.