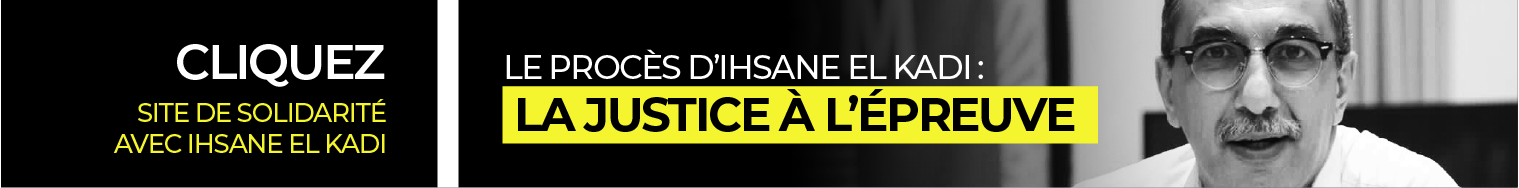Une garde à vue qui file vers les 9 jours. Les sécuritaires veulent-ils sérieusement criminaliser le militantisme humanitaire ?
La Division Centre de la Police Judiciaire, rue Rabah Saâdane, détient en garde à vue depuis une semaine une professeure agronome retraitée de l’université de Blida, Fatiha Briki, militante humanitaire, mobilisée dans la solidarité avec les détenus du Hirak.
A la mi-mai dernier, Kenza Khatto, notre collègue journaliste est, elle aussi, restée en garde à vue, 4 jours durant, au même endroit. Le procès public a montré dès ses premières minutes toutes les atteintes au code de procédure pénale dont a été victime la journaliste qui a finalement comparu libre une semaine après sa présentation en comparution immédiate. Elle avait été interpellée et brutalisée au cours de son activité professionnelle.
Les services de police judiciaire peuvent-ils se prévaloir cette fois dans le cas de Fatiha Briki, d’éléments à charge qui justifient le traitement réservé à l’universitaire qui milite pour la libération des détenus politiques ? Les enquêteurs de la PJ pensent sans doute que oui. La réalité est que nous sommes dans l’affaire Briki dans un dérapage incontrôlé d’une opération « stratégique » lancée par les sécuritaires depuis avril dernier. Elle consiste à criminaliser le militantisme de solidarité, sous couvert qu’il serait soutenu par de l’argent suspect. Cette option est en vérité, une volonté de restaurer un le climat judiciaire de la lutte contre le terrorisme des années 90 et au-delà. Transposition paresseuse et grossière. Les collectifs du Hirak solidaires avec les détenus politiques d’aujourd’hui « tombent » dans la même situation vis à vis de la loi que les réseaux d’aide aux groupes terroristes, en argent et en logistique, d’hier. Il manquait une case officielle, à défaut d’être légale, pour achever la greffe : désigner des organisations terroristes dans le paysage politique algérien. C’est chose faite avec Rachad et le MAK.
Les « affaires judiciaires » consistent donc aujourd’hui, à accuser les militants humanitaires des collectifs solidaires avec les détenus d’avoir bénéficié de financements occultes, forcément en relation avec les organisations néo-terroristes. Le cadre général est donc celui-là : distiller semaine après semaine, interpellation après interpellation, le sentiment d’un vaste complot : les détenus du Hirak seraient liées, d’une façon ou d’une autre, à ces organisations fraîchement terroristes, et la preuve serait donc qu’ils bénéficient de campagne de solidarité qui ne pourraient pas exister sans un financement occulte, sans doute celui de ces organisations mêmes.
Les faits ne collent pas
Fatiha Briki, silhouette brune et furtive, était toujours à nos côtés dans les piquets à la maison de la presse en 2020 durant la campagne pour la libération de Khaled Drareni. Regard d’ange au-dessus de la bavette de rigueur. Le son en bémol. Discrète. La police judiciaire aura du mal à en faire autre chose que ce qu’elle est. Une citoyenne professeur d’agronomie retraitée de l’université de Blida, écorchée vive, sensible à tout ce qui touche à l’intégrité du magnifique peuple du 22 février 2019.
La nouvelle-ancienne stratégie de la criminalisation du Hirak par son supposé financement a connu des hauts et des bas depuis début avril dernier. Surtout des bas. Les accusés et les faits reprochés ne collent pas au film. A Oran, les sécuritaires ont tenté d’établir un lien entre la ligue des droits humains, présidée par Kaddour Chouicha et un prétendu « financement » de Rachad. La suite judiciaire a souffert de trous d’air évidents dans l’accusation.
Dans l’affaire de SOS Bab El Oued mobilisé autour du sort des détenus des quartiers populaires, la communication du parquet a évoqué huit personnes incriminées, rendant l’affaire ronflante avec le financement d’une ambassade étrangère. Les avocats n’ont pas retrouvé dans le dossier les faits cités et les parties incriminées. Signe de décrépitude de ce dossier à charge construit pour les besoins politiques pressants des sécuritaires, il aura fallu lui donner de « l’étoffe » en mettant sous contrôle judicaire un journaliste économique du service public radio et télévision, pour avoir assuré des formations pour le compte de l’association.
Avec Fatiha Briki, il faudra renforcer beaucoup plus le « scénario » pour habiller ce narratif du financement occulte qui veut criminaliser la solidarité humanitaire. D’autres militants ont été interpellés ou convoqués pour les besoins de cette enquête. El Hadi Lassouli, agriculteur érudit, Massi Rezzag, syndicaliste, Nawel Laïb, photographe de métier et des universitaires : Mahanna Abdesselam, Sara Ladoul et Mohamed Yagouni. Des perquisitions ont été conduites à leur domicile. L’opinion est ainsi, en mode subliminale, préparée à de « grandes révélations ». La transposition en cours d’un mécanisme judiciaire – sans doute opportun dans les années du terrorisme afin de traquer ses soutiens actifs – vers le contexte du mouvement populaire pacifique de 2021 est une option de politique sécuritaire déroutante par sa légèreté.
Comme le drapeau amazigh
Des dizaines de milliers d’Algériens ont soutenu et soutiennent, dans toutes les wilayas par différentes formes les détenus du Hirak. Ramener ce mouvement de solidarité à « un complot financier » méprise les codes populaires d’entre-aide face à l’adversité. Les corporations sont plus mobilisées pour les leurs. Les universitaires se déploient pour les enseignants ou les étudiants, les journalistes occupent le pavé pour leurs collègues, et les avocats font grève pour l’un des leurs. L’argent n’est jamais le moteur de ces mouvements ou les réseaux sociaux complètent les manifestations de rues. Feindre de le croire est dangereux et improductif dans l’impasse politique actuelle. Il faut bien se souvenir que le premier « incitateur » à l’organisation autour des détenus est bien l’Etat geôlier.
Le Hirak a fait de grands bonds dans la coordination à partir de la fin de l’été 2019, lorsque la répression s’est instituée. Les collectifs que pourchasse aujourd’hui cette « stratégie » aventureuse du « déni de solidarité ». Le Réseau contre la Répression, Le CNLD, la CNUAC, le comité contre la torture et les conditions carcérales inhumaines, ainsi que les autres collectifs locaux, sont nés pour la plupart dans la mouvance pour la libération des détenus. Ils sont devenus plus visibles au fur et à mesure que la répression s’est aggravée.
L’escalade vers l’Etat de siège qui ne dit pas son nom, a provoqué la naissance d’un Front National Contre la Répression il y’ a deux semaines. La restauration autoritaire avait réussi à détourner une partie de l’énergie du Hirak vers les luttes défensives pour libérer ses détenus. Elle interdit aujourd’hui, avec près de 300 détenus politiques, la poursuite de ce combat élémentaire, qui pourtant risque momentanément de faire passer au second plan les revendications de changement démocratique, cœur du mouvement populaire. Il s’agit tout simplement d’un pari insensé. Un peu comme celui de la criminalisation du port de l’emblème amazigh en juin 2019. Lancée dans son dérapage, la stratégie du « déni de solidarité » en arrive à questionner les familles des détenus sur l’origine des fonds pour payer les avocats. Tout le monde au sein du Hirak et autour de lui, sait pourtant que le collectif des avocats qui défend les victimes de la répression le fait bénévolement. Là aussi l’argent est expurgé de la solidarité. A rebours de la théorie du complot en cours de narration. Le rôle du collectif des avocats est d’ailleurs essentiel dans la campagne pour la libération des détenus à côté de celui des collectifs humanitaires et des ligues des droits de l’homme.
C’est sans doute, d’ailleurs, pour cela que les avocats ont été ciblé récemment avec l’incarcération de l’un des leurs à Tébessa, Abderraouf Arslane, qui est à son 29e jour de détention. La tentative glaçante de superposer dans l’imaginaire de l’opinion les réseaux de soutien au terrorisme des années 90 et le réseau des collectifs humanitaires de soutien aux détenus du mouvement populaire pacifique de 2019-2021 est la pire invention d’officines de ces dernières décennies. Elle va précipiter l’Algérie au fond de la liste des Etats liberticides dans le monde. Elle met en difficulté la DGSN obligée de rallonger « laborieusement » une garde à vue pour entrer dans le moule d’un dossier « important ». Elle va mettre en porte à faux la justice face au regard lumineux de Fatiha Briki, cette femme au courage tranquille, mère emblématique de tous les jeunes détenus de « l’Algérie nouvelle ».
Une filiation vaille que vaille avec le terrorisme ? Peut-être dans la terminologie coloniale, à travers son père, Yahia Briki, membre des combattants de la liberté (Maquis Rouge), deux fois condamné à mort, notamment pour l’attentat manqué contre le général Massu.